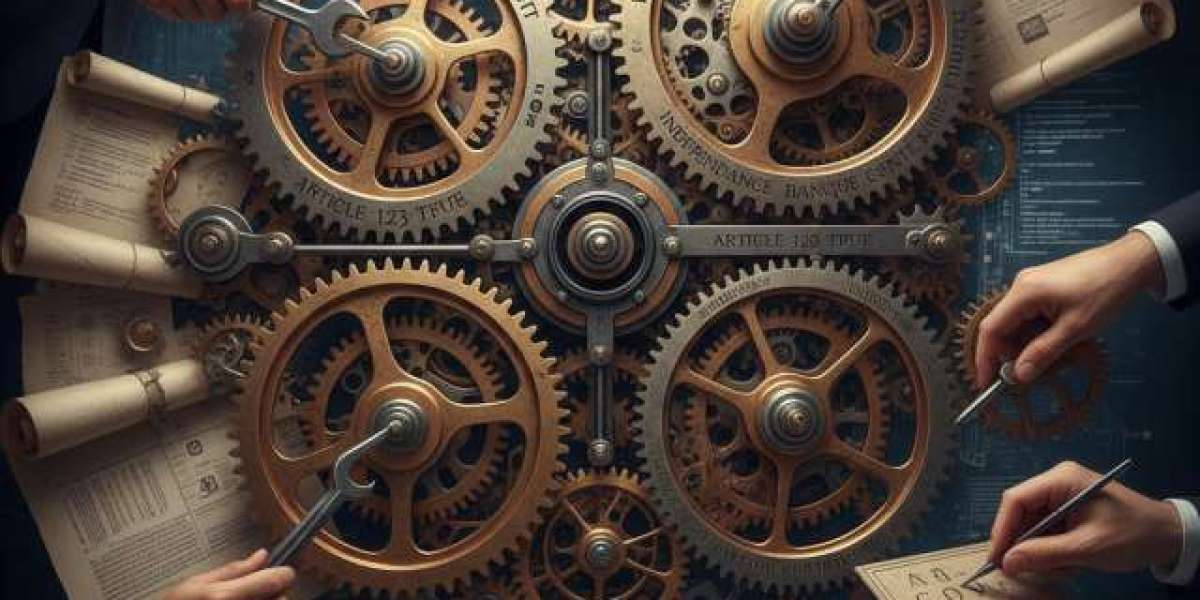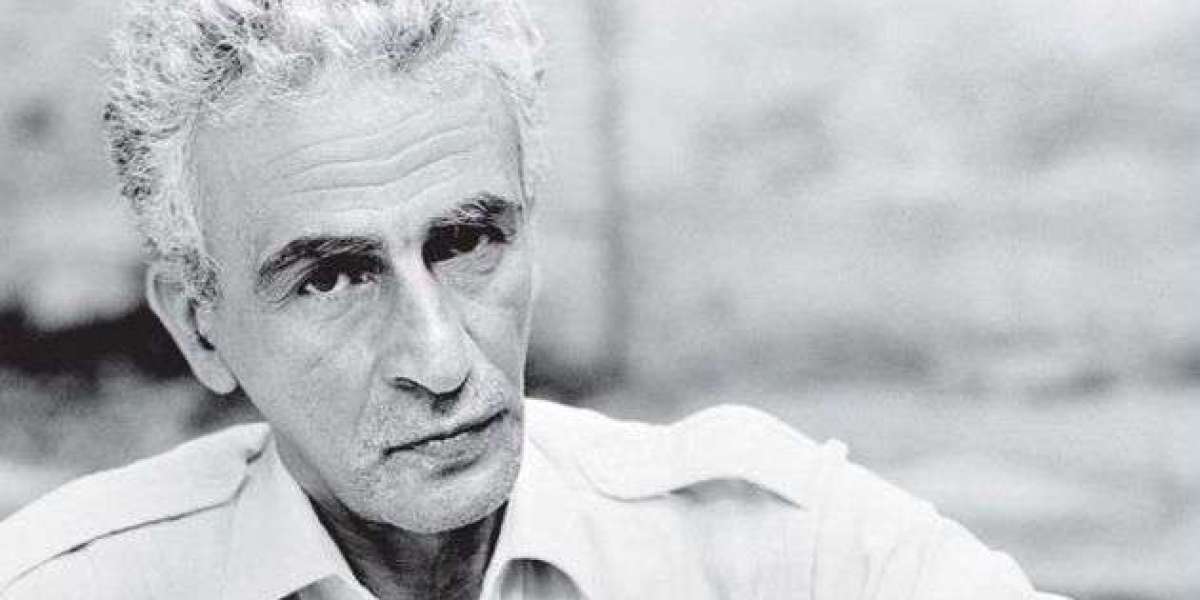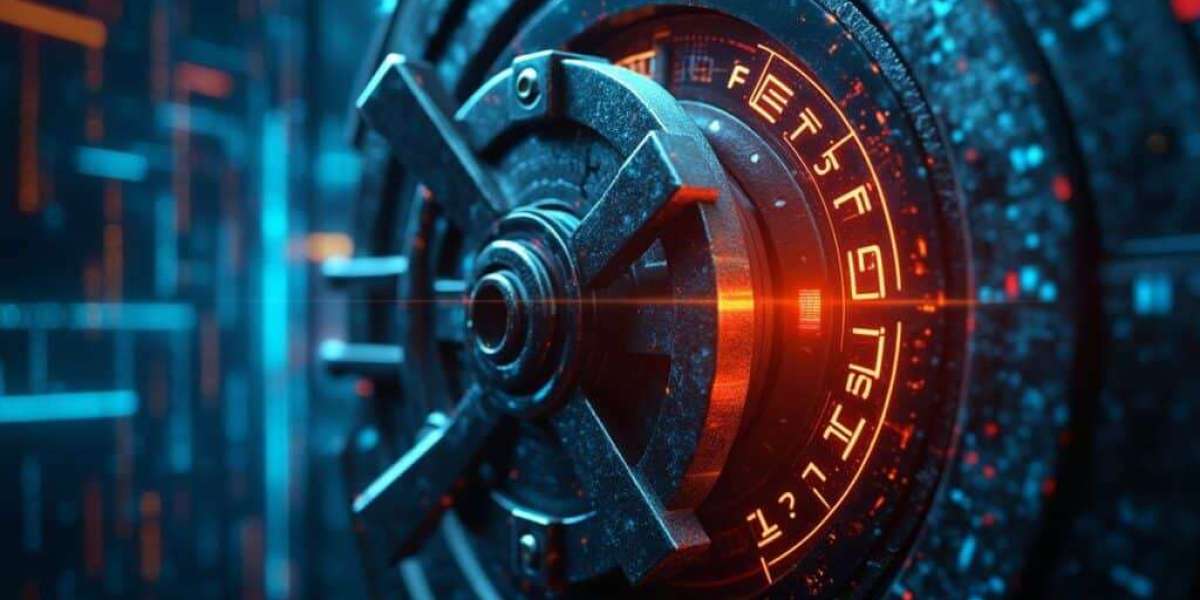Introduction :
Depuis deux siècles, la pensée économique dominante a présenté les « lois du marché » comme des vérités universelles, comparables aux lois de la physique. Cette naturalisation, héritée des pères du libéralisme, a été reprise avec une rigueur mathématique par la théorie néoclassique, prétendant que l’offre et la demande s’équilibrent spontanément pour assurer le bien-être collectif.
Mais il s’agit là d’une illusion scientifique. Comme l’a montré Karl Polanyi dans La Grande Transformation (1944), le marché est une institution historique, encastrée dans la société et jamais indépendante d’elle. La présentation de ses règles comme des lois « naturelles » constitue donc moins une découverte qu’une imposture intellectuelle, destinée à légitimer un ordre social.
Cette mystification a eu des effets redoutables : elle a justifié l’exploitation, légitimé les inégalités, et alimenté une logique de prédation qui a conduit à la crise écologique actuelle. Contre cette imposture, il est urgent de redéfinir les véritables lois naturelles de l’économie, celles qui, loin des fictions idéologiques, expriment les conditions de la vie et de la survie collective.
I. La naturalisation fictive du marché :
D’Adam Smith à Léon Walras, la métaphore dominante a été celle d’un marché autorégulé, capable de tendre vers un équilibre comme les corps célestes suivent les lois de Newton. Smith, dans La richesse des nations (1776), a popularisé l’image de la « main invisible », par laquelle la poursuite des intérêts individuels conduirait au bien commun.
Mais cette naturalisation est trompeuse. Comme le rappelle Polanyi, « le marché autorégulateur n’a jamais existé et ne peut pas exister ». Il suppose des conditions politiques – monnaie stable, droits de propriété, cadre juridique – qui sont le fruit de choix sociaux et institutionnels. Le présenter comme « nature » revient à dépolitiser l’économie, à effacer la question du juste et de l’injuste.
II. L’escroquerie au service de l'ordre établi :
Cette fiction a eu une fonction politique claire : neutraliser la critique. Si les « lois du marché » sont aussi inéluctables que la gravitation, alors toute contestation est vaine. Margaret Thatcher, reprenant le slogan néolibéral TINA (« There Is No Alternative »), n’a fait que répéter cette idée.
Comme l’a montré Joseph Stiglitz (Globalization and Its Discontents, 2002), ces dogmes ont servi de justification aux programmes de privatisation et de dérégulation imposés par le FMI et la Banque mondiale. L’économie, d’outil critique qu’elle était au temps de Ricardo ou Marx, est devenue une technocratie gestionnaire, servant les intérêts des puissances financières.
III. Les ravages sociaux, politiques et écologiques :
Les conséquences sont multiples :
-
Sur le plan social, la croyance dans l’autorégulation a légitimé la précarisation du travail et la réduction des protections sociales. Pierre Bourdieu a dénoncé cette « utopie néolibérale » qui détruit les solidarités.
-
Sur le plan politique, les nations ont vu leur souveraineté amputée, leurs choix dictés par des « lois économiques » présentées comme incontournables.
-
Sur le plan écologique, l’illusion d’une croissance infinie a conduit à l’épuisement des ressources, confirmant le diagnostic de Nicholas Georgescu-Roegen (The Entropy Law and the Economic Process, 1971) : l’économie obéit à la loi de l’entropie, et non à un cycle perpétuel.
Ainsi, loin d’être des lois de la nature, les lois du marché sont des constructions historiques ayant engendré des ravages réels.
IV. Les véritables lois naturelles de l’économie :
Contre cette imposture, il faut restituer à l’économie son enracinement dans la vie. Ces lois ne sont pas écrites dans les équations des manuels néoclassiques, mais elles se retrouvent dans l’anthropologie, l’écologie et l’histoire des civilisations.
-
La loi de l’interdépendance L’économie est un réseau vital. Elle relie humains, nature et techniques dans un tissu d’échanges. Elinor Ostrom, prix Nobel en 2009, a montré que les communautés humaines gèrent souvent les ressources partagées de manière coopérative et durable, bien au-delà du modèle individualiste.
-
La loi de l’abondance potentielle La rareté n’est pas une donnée naturelle, mais une construction historique. Le soleil offre chaque jour mille fois plus d’énergie que l’humanité n’en consomme ; la connaissance, comme l’a souligné Yochai Benkler (The Wealth of Networks, 2006), croît par le partage. L’économie doit être l’art de révéler et de distribuer cette abondance, et non de gérer artificiellement la pénurie.
-
La loi de la réciprocité Marcel Mauss, dans Essai sur le don (1925), a montré que l’économie humaine repose d’abord sur le don et le contre-don. Le marché n’est viable que parce qu’il s’appuie en amont sur un tissu de solidarité et de confiance. Toute économie qui nie cette dimension anthropologique détruit le lien social.
-
La loi de la temporalité Les sociétés obéissent à des cycles historiques. Fernand Braudel et les historiens des Annales ont montré l’importance des longues durées. De même, la Natiométrie propose un cadran de 128 ans pour saisir la dynamique des nations. Penser l’économie sans temporalité, c’est tomber dans l’illusion d’une croissance infinie.
-
La loi de la justice Comme l’a observé Aristote déjà, aucune cité ne survit à l’excès d’inégalités. Thomas Piketty (Le capital au XXIe siècle, 2013) a démontré que les sociétés qui laissent se creuser les écarts de richesse sont condamnées à la crise politique et sociale. La justice est donc une loi naturelle de stabilité sociale, non une simple exigence morale.
Conclusion :
L’histoire retiendra que l’une des plus grandes impostures intellectuelles fut d’avoir présenté le marché comme une nature. Cette escroquerie a permis de gouverner les peuples en neutralisant la critique, tout en conduisant le monde à une triple crise : sociale, politique et écologique.
Il est urgent de briser ce sortilège, de retrouver les véritables lois naturelles de l’économie : interdépendance, abondance potentielle, réciprocité, temporalité et justice. Ce cadre refonde l’économie comme science critique et comme art de la vie, au service de la survie et de la dignité des sociétés.
Loin des fictions de l’équilibre automatique, il s’agit de réconcilier l’économie avec la nature, l’histoire et l’humanité. C’est à ce prix qu’elle pourra redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une science de la vie et non une technique de domination.