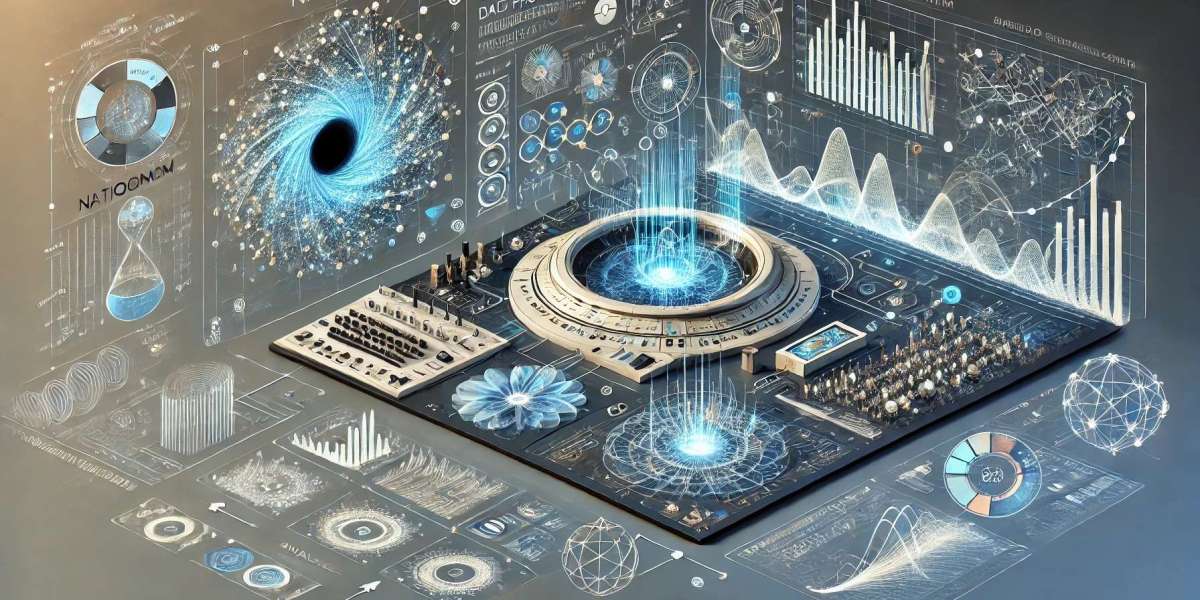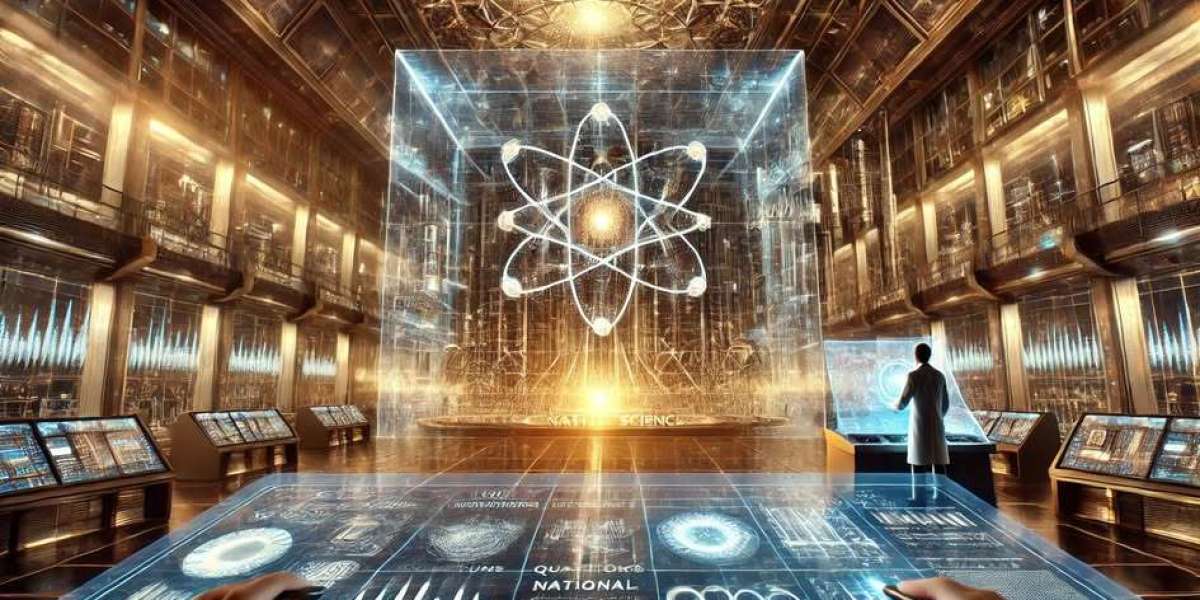Introduction :
Depuis deux siècles, l’économie dominante s’est présentée comme une science exacte, régie par des « lois naturelles » comparables à celles de la physique. Le marché, dit-on, obéirait à des régularités immuables : l’offre, la demande, la concurrence, l’équilibre. Pourtant, comme l’a magistralement montré Karl Polanyi (La Grande Transformation, 1944), ce marché « autorégulé » est une invention récente, imposée par l’histoire moderne et non une donnée de la nature.
En naturalisant ce qui n’est qu’une construction sociale, l’orthodoxie économique a commis une imposture intellectuelle : faire passer des conventions idéologiques pour des lois universelles. Cette imposture a eu des effets dramatiques — destruction écologique, creusement des inégalités, dissolution du lien social.
Il s’agit aujourd’hui de refonder l’économie sur ses véritables lois naturelles. La Natiométrie propose un cadre inédit, mesurable et rigoureux, en identifiant cinq lois natiométriques de l’économie, enracinées dans la vie biologique, sociale et civilisationnelle.
I. La loi de l’interdépendance : l’économie comme tissu vital.
Adam Smith lui-même, souvent caricaturé en père du libéralisme, reconnaissait dans La Richesse des Nations (1776) que nul ne produit pour lui seul : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner… ». L’économie est d’abord un réseau de dépendances mutuelles.
Au XXIᵉ siècle, l’écologie politique (Latour, Morin) rappelle que cette interdépendance ne se limite pas aux humains : l’air, la terre, l’énergie solaire sont des conditions vitales. La loi natiométrique de l’interdépendance établit donc que l’économie n’est pas une mécanique d’individus isolés mais l’organisation d’un réseau vital, liant humains, sociétés et biosphère.
II. La loi de l’abondance potentielle : dépasser le dogme de la rareté.
La science économique moderne, depuis Lionel Robbins (1932), définit l’économie comme « la science de la rareté ». Or, cette définition est idéologique : la rareté n’est pas une loi naturelle, mais une condition historique, produite par l’accumulation privée et le gaspillage.
Nicholas Georgescu-Roegen (The Entropy Law and the Economic Process, 1971) a montré que la véritable limite est l’entropie, non la rareté. Elinor Ostrom (Governing the Commons, 1990) a démontré que la gestion collective des ressources peut créer de l’abondance, contredisant la vision pessimiste de la « tragédie des communs ».
Chaque jour, le soleil envoie mille fois plus d’énergie que l’humanité n’en consomme. La matière est transformable à l’infini. La connaissance croît par le partage. La loi de l’abondance potentielle énonce donc que l’économie véritable doit révéler et distribuer l’abondance, plutôt que gérer artificiellement la pénurie.
III. La loi de la réciprocité : l’économie comme lien social.
Bien avant les marchés, les sociétés humaines ont vécu du don et du contre-don. Marcel Mauss (Essai sur le don, 1925) a montré que ces échanges étaient fondateurs de la cohésion sociale. Polanyi a confirmé que les marchés modernes ne sont qu’un mode particulier et récent d’organisation, greffé sur des logiques plus anciennes de réciprocité et de redistribution.
Même Friedrich Hayek, dans Droit, législation et liberté (1973-79), reconnaissait que les règles implicites, la confiance et les traditions sont des conditions de viabilité du marché. La loi de la réciprocité rappelle donc que sans confiance et reconnaissance mutuelle, aucun échange durable n’est possible.
IV. La loi de la temporalité : l’économie comme rythme et cycle.
L’économie n’est pas un état statique mais une dynamique historique. Joseph Schumpeter (Business Cycles, 1939) a montré que l’innovation engendre des cycles de croissance et de crise. Fernand Braudel (Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 1979) distinguait le temps court du marché, le temps moyen des conjonctures et le temps long des civilisations.
La Natiométrie ajoute une mesure précise : le cycle de 128 ans, qui scande l’évolution des nations et permet d’inscrire l’économie dans une dynamique mesurable et prédictible. La loi de la temporalité impose donc de penser l’économie comme un processus rythmé par des cycles, et non comme une croissance linéaire infinie.
V. La loi de la justice : l’équilibre par la redistribution.
De tout temps, les sociétés se sont effondrées sous le poids de l’injustice. Aristote affirmait déjà que nulle cité ne survit si l’inégalité est extrême. Karl Marx, dans Le Capital (1867), a montré que l’accumulation sans limites engendre la crise.
Plus récemment, Thomas Piketty (Le Capital au XXIe siècle, 2013) a démontré empiriquement que la concentration des richesses mène inévitablement à l’instabilité sociale et politique. La loi natiométrique de la justice énonce que la redistribution n’est pas un choix moral, mais une condition de survie des sociétés.
Conclusion :
Les soi-disant « lois naturelles du marché » n’étaient qu’une mystification : elles ont masqué des rapports de force derrière une prétendue nécessité scientifique. En leur substituant les cinq lois natiométriques de l’économie — interdépendance, abondance potentielle, réciprocité, temporalité et justice — la Natiométrie restitue à l’économie son socle réel, enraciné dans la vie, la société et la nature.
Il ne s’agit ni de socialisme, ni de libéralisme, mais d’un dépassement des idéologies. Ces lois natiométriques inscrivent l’économie dans le champ des sciences de la vie collective, au service de l’émancipation humaine et de la durabilité civilisationnelle.