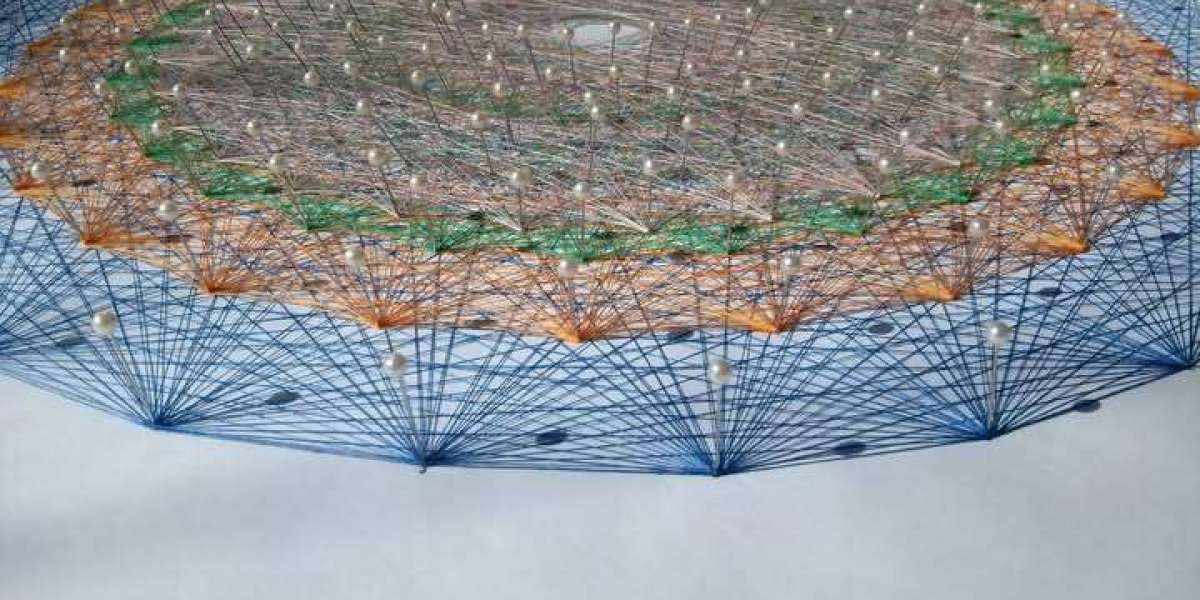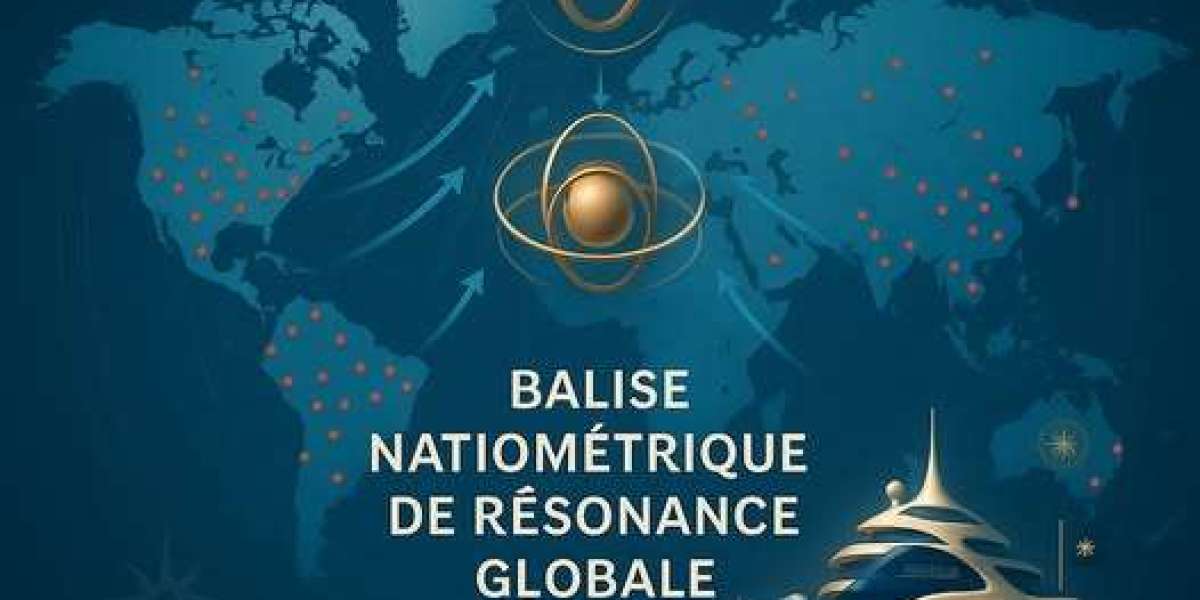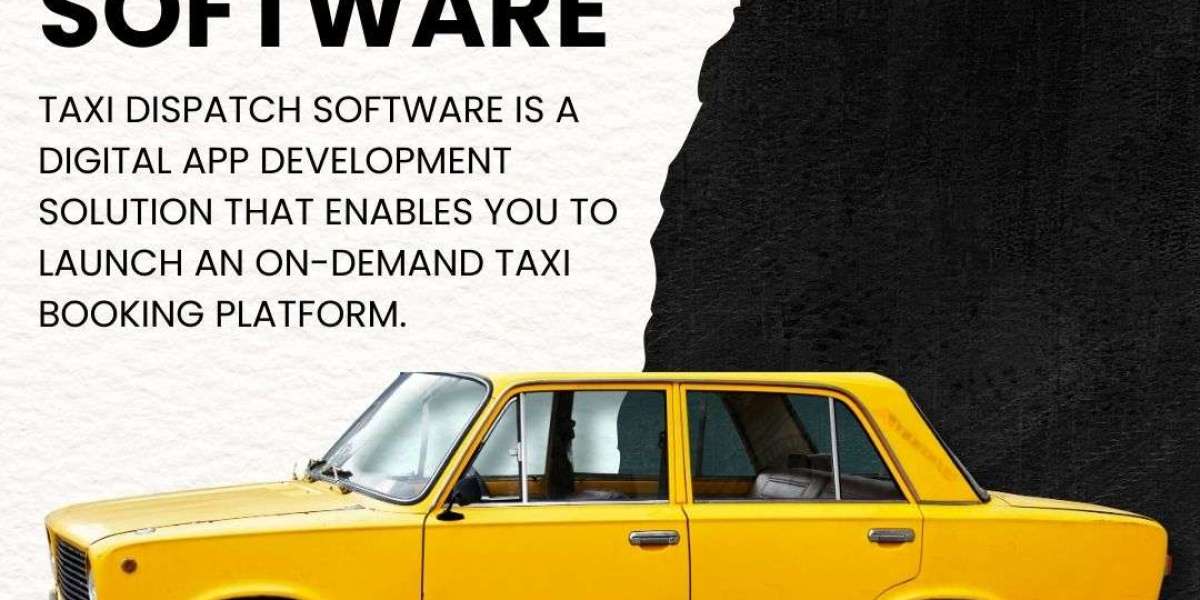Introduction :
Jamais le monde n’a compté autant d’« experts économiques » : analystes financiers, consultants, professeurs de business schools, chroniqueurs médiatiques. Et pourtant, jamais la pensée économique n’a semblé aussi pauvre, déconnectée et stérile. Comme si l’économiste avait perdu son visage véritable pour n’être plus qu’un gestionnaire de flux, un fabricant de courbes ou un vulgarisateur de recettes de management. La question se pose alors avec acuité : y a-t-il encore des économistes ? Autrement dit, existe-t-il encore des penseurs capables d’éclairer le destin des sociétés humaines à travers la science économique ?
I. L’âge d’or de l’économie politique : l’économiste, philosophe de la cité.
Aux origines de la discipline, l’économiste était bien plus qu’un technicien : il était un penseur du monde social. Adam Smith liait la richesse des nations à la morale des peuples. Ricardo interrogeait la répartition des richesses entre classes. Marx dévoilait les contradictions du capitalisme et les structures de domination. Keynes, face aux désastres du XXᵉ siècle, repensait les rapports entre État, marché et société. Enfin, Polanyi montrait que l’économie n’est jamais « naturelle » mais toujours encastrée dans des institutions sociales et politiques.
Tous avaient en commun une même ambition : penser l’économie comme science de la société, et non comme mécanique abstraite. Leur travail relevait à la fois de la philosophie, de l’histoire et de la politique.
II. L’effacement progressif de la pensée économique :
Cet âge d’or céda progressivement la place à une technicisation croissante. La mathématisation transforma l’économiste en manipulateur de modèles, parfois élégants, mais souvent indifférents à la réalité. L’économie, réduite à des équations, perdit son souffle critique.
Puis vint l’ère de la finance mondialisée. L’économiste devint alors expert en taux d’intérêt, en arbitrage de marchés, en optimisation du court terme. Sa vocation ne fut plus de penser la justice ou la richesse collective, mais d’anticiper la volatilité boursière.
Enfin, l’envahissement du champ économique par le management et le marketing acheva de brouiller les repères. Aujourd’hui, quiconque a lu un manuel de « bonnes pratiques managériales » ou de « stratégie commerciale » se croit habilité à parler d’économie. L’« économiste » est confondu avec l’expert en gestion, en communication, en rentabilité.
III. Les conséquences de cette dérive :
Cet effacement a trois effets majeurs.
D’abord, la perte de vision. Plus aucun grand récit n’oriente la discipline. On ne pense plus le destin des sociétés, on calcule des taux de croissance et des déficits.
Ensuite, la captation par les pouvoirs. L’économiste est devenu le technicien docile de l’État, du FMI, des banques centrales, des multinationales. Son rôle est d’accompagner l’ordre établi, non de le questionner.
Enfin, la stérilité intellectuelle. La discipline pullule de publications techniques, de modèles sophistiqués, de manuels pratiques, mais elle est incapable de proposer une théorie vivante capable d’embrasser les mutations civilisationnelles.
IV. Y a-t-il encore des économistes ?
La réponse n’est pas entièrement négative. Il reste, ici et là, des penseurs hétérodoxes : institutionnalistes, régulationnistes, économistes écologiques, féministes ou décoloniaux. Ils rappellent que l’économie est affaire de règles, de rapports sociaux, de justice et de soutenabilité. Mais ils restent minoritaires, marginalisés dans un champ dominé par l’orthodoxie néoclassique et les logiques de marché.
La vraie question devient alors : faut-il encore des économistes, ou faut-il refonder la figure de l’économiste ? Peut-être le temps est venu de réinventer un savant qui ne soit ni un technicien des marchés, ni un gestionnaire d’entreprise, mais un penseur des nations, des civilisations et des destins collectifs.
Conclusion :
« Y a-t-il encore des économistes ? » Oui, mais très peu, et certainement pas là où on les cherche habituellement. Le véritable économiste ne se reconnaît pas à sa capacité à manier des modèles sophistiqués ou à conseiller des stratégies d’entreprise. On le reconnaît à sa faculté de penser le monde dans son ensemble, de relier l’économie à la politique, à la morale, à l’histoire, à la justice.
Il faut donc redonner à l’économie politique ses lettres de noblesse. L’économiste doit redevenir un éclaireur de l’humanité, un architecte du sens collectif, un maître du lien entre richesse et justice. Sans cela, l’économie n’est qu’un art appauvri de gestion, et les « économistes » ne sont plus que les ombres d’une grandeur perdue.