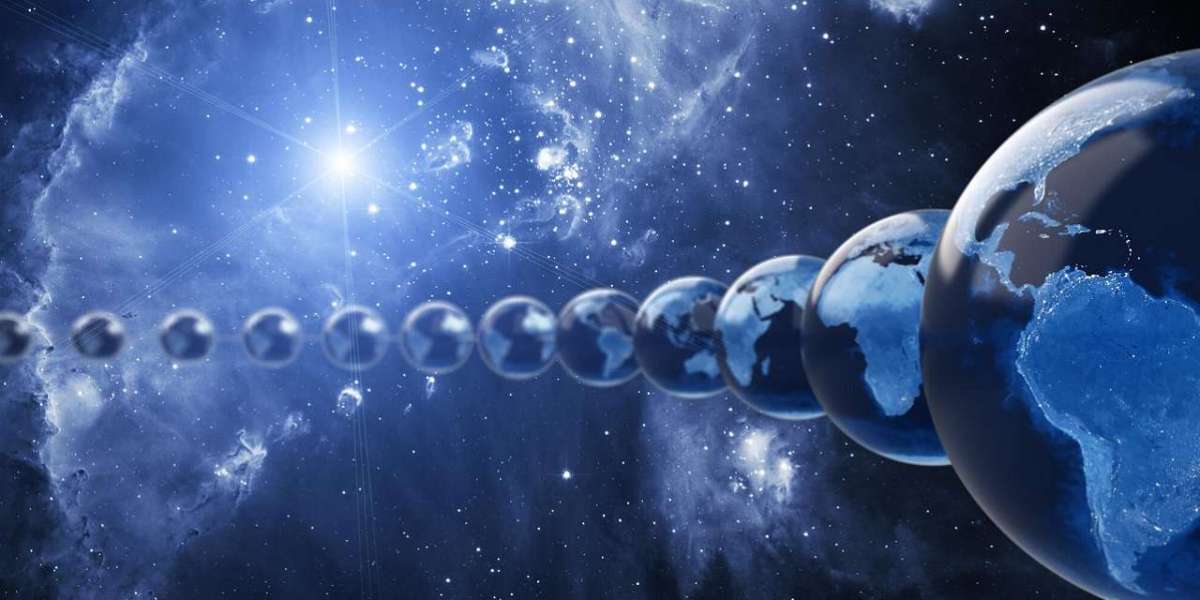Fiche conceptuelle académique.
L’Agentivité : concept, portée et implications.
1. Définition générale :
L’agentivité (du latin agens, « agir ») désigne la capacité d’un individu ou d’un collectif à agir intentionnellement sur le monde, à orienter son environnement et son devenir, plutôt que de subir passivement les forces extérieures. Elle se distingue de la simple action par son enracinement dans la conscience de soi, l’autonomie et la finalité.
En sciences sociales, l’agentivité est souvent mise en contraste avec la structure : là où la structure représente les contraintes, les normes et les institutions qui encadrent l’existence, l’agentivité incarne la puissance créatrice et transformatrice des sujets.
2. Genèse et champs disciplinaires
- Philosophie et phénoménologie : l’agentivité est liée à la liberté et à la responsabilité. Sartre ou Arendt soulignent le pouvoir de « commencer » et de « s’auto-déterminer ».
- Sociologie et anthropologie : l’agentivité s’oppose à la simple reproduction sociale (Bourdieu) et interroge la marge de manœuvre des individus dans des structures contraignantes.
- Psychologie cognitive et développementale : l’agentivité est comprise comme la capacité à se percevoir comme l’origine de ses propres actions (notion de self-efficacy chez Bandura).
- Sciences politiques : elle se traduit par la participation active des citoyens et des nations à la fabrique de leur destin.
3. Dimensions constitutives :
L’agentivité peut être décomposée en plusieurs dimensions :
- Conscience : reconnaissance de sa capacité à agir.
- Intentionnalité : orientation des actions vers un but.
- Efficacité : aptitude réelle à produire un effet sur l’environnement.
- Responsabilité : reconnaissance et prise en charge des conséquences de ses actes.
- Collectivité : dépassement du cadre individuel, par la capacité d’un groupe ou d’une nation à se constituer en sujet historique.
4. Agentivité et Natiométrie :
Dans le cadre de la Natiométrie, l’agentivité prend une signification renouvelée :
- Elle devient la mesure de la puissance créatrice d’une nation à s’auto-définir et à s’auto-organiser.
- Elle s’inscrit dans le cycle civilisationnel observé par le Natiomètre, où les nations sont soumises à des dynamiques cycliques mais conservent une capacité à infléchir leur trajectoire.
- L’agentivité se présente comme une variable stratégique pour comprendre pourquoi certaines nations reprennent le gouvernail de leur histoire, tandis que d’autres s’abandonnent à l’inertie ou à la dépendance.
5. Implications pratiques :
- Politiques publiques : encourager l’agentivité citoyenne signifie promouvoir l’éducation critique, la participation civique et la créativité collective.
- Gouvernance internationale : la reconnaissance de l’agentivité des peuples fonde une diplomatie plus équitable et respectueuse des souverainetés.
- Science et technologie : les outils de la Natiométrie visent à outiller l’agentivité collective, en fournissant aux nations une boussole scientifique pour orienter leurs choix.
6. Conclusion :
L’agentivité ne désigne pas seulement la capacité d’agir, mais l’affirmation d’une puissance de transformation consciente et responsable, qu’il s’agisse d’individus, de peuples ou de nations. Dans la perspective natiométrique, elle devient la clé de voûte de la souveraineté civilisationnelle, l’art de reprendre le gouvernail de l’Histoire et de ne pas se laisser emporter par les courants aveugles du temps.