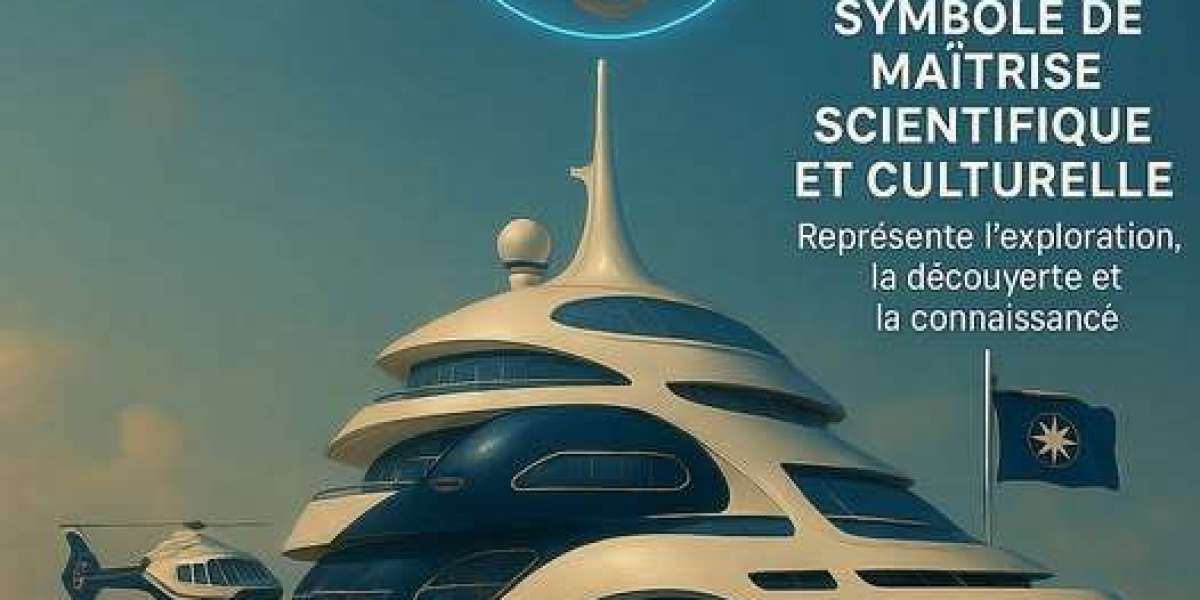Introduction :
Dans un monde où les certitudes géopolitiques s’effritent et où la logique des blocs s’estompe, les États de moyenne puissance sont contraints d’inventer de nouvelles grammaires de puissance. La rigidité des alliances du XXᵉ siècle laisse place à des configurations plus souples, où la souveraineté se mesure à la capacité d’agir sans se soumettre. C’est dans ce contexte que l’article de Tewfik Hamel, « Rééquilibrer sans s’aligner : la recomposition du dialogue de défense entre l’Algérie et les États-Unis », prend toute sa portée.
L’auteur y analyse avec précision le tournant diplomatique amorcé par Alger depuis 2024-2025 : un rapprochement pragmatique avec Washington, fondé sur la confiance mesurée, la modularité et le respect mutuel des souverainetés. Mais au-delà du cas militaire, cette relation esquisse les contours d’une doctrine nouvelle : celle d’une diplomatie de l’autonomie relationnelle, capable de conjuguer ouverture et indépendance.
Comment ce modèle algérien de coopération sans alignement peut-il inspirer une redéfinition de la diplomatie au XXIᵉ siècle ? Autrement dit, comment réconcilier la souveraineté nationale avec l’interdépendance mondiale ?
Pour répondre à cette question, il convient de montrer d’abord que le rééquilibrage diplomatique contemporain consacre la fin des logiques d’alignement (I) ; puis que l’autonomie ne réside plus dans le repli, mais dans la capacité à réguler ses interdépendances (II) ; enfin, que cette évolution annonce l’émergence d’une diplomatie nouvelle : celle de la coopération à empreinte limitée, fondée sur la prudence, la confiance et la cohérence (III).
I. La fin des alignements : vers un monde de souverainetés fluides :
Pendant plus d’un demi-siècle, la scène internationale s’est organisée autour de blocs figés. L’alignement sur une puissance tutélaire était le prix à payer pour la sécurité. Cette logique binaire — allié ou adversaire — a longtemps structuré les comportements diplomatiques. Mais l’effondrement de la bipolarité et la montée des puissances régionales ont bouleversé ce schéma.
Le monde contemporain n’est plus celui de la fidélité, mais celui de la flexibilité. Les États ne cherchent plus à appartenir à un camp, mais à composer leur propre équilibre. Dans cette nouvelle architecture, le non-alignement n’est plus synonyme de neutralité passive. Il devient un principe d’action stratégique, un art de la manœuvre entre plusieurs pôles d’influence.
L’Algérie illustre ce tournant doctrinal. Son rapprochement avec les États-Unis, sans rupture avec Moscou, traduit une vision multipolaire du pouvoir : coopérer avec tous, se soumettre à personne. Hamel montre bien que cette posture ne repose pas sur l’opportunisme, mais sur une philosophie de la mesure — un équilibre réfléchi entre ouverture et vigilance.
Ainsi, le non-alignement du XXIᵉ siècle n’est plus une posture défensive. C’est une forme active de souveraineté, où l’État affirme sa liberté en diversifiant ses dépendances. La diplomatie devient alors un exercice d’équilibrisme maîtrisé, fondé sur la fluidité des souverainetés plutôt que sur leur rigidité.
II. L’autonomie relationnelle : la nouvelle forme de la puissance :
Dans l’analyse de Hamel, une idée centrale se dégage : la souveraineté moderne n’est plus l’absence de dépendance, mais la gestion intelligente des dépendances. Autrement dit, un État souverain n’est plus celui qui se coupe du monde, mais celui qui choisit les conditions de son interconnexion.
C’est ce que l’on peut appeler l’autonomie relationnelle. L’Algérie n’abandonne pas ses principes de non-alignement ; elle les modernise en apprenant à calibrer ses coopérations. Le mémorandum d’entente signé avec AFRICOM en 2025 ne crée pas d’alliance, mais une structure de dialogue : groupes de travail, commissions mixtes, projets sectoriels. Cette modularité diplomatique est une innovation majeure. Elle permet de bâtir une interopérabilité ciblée sans altérer l’indépendance doctrinale.
Hamel parle de « laboratoires de confiance ». L’expression est heureuse. Dans un monde de méfiance systémique, la confiance devient une ressource rare et stratégique. Elle ne se décrète pas : elle se construit, pas à pas, à travers des expériences communes. Chaque exercice naval, chaque échange médical, chaque partage de renseignement devient une brique de confiance cumulative.
Ainsi se dessine une diplomatie du pragmatisme réversible : on coopère sans s’engager irrévocablement, on apprend sans s’aligner. Cette approche, fondée sur la mesure et la gradation, confère à la diplomatie une dimension d’apprentissage permanent. L’État n’est plus un acteur figé, mais un organisme vivant, adaptatif, capable d’évoluer sans renier ses principes.
III. Vers une diplomatie de la coopération à empreinte limitée :
L’un des apports implicites de l’article de Tewfik Hamel est de montrer que la puissance moderne n’est plus coercitive, mais cognitive. L’Algérie ne cherche pas à importer des armes, mais des savoirs : maîtrise du renseignement, logistique médicale, technologies de communication. Le cœur de la diplomatie contemporaine est là : dans la circulation maîtrisée de la connaissance stratégique.
Apprendre des autres sans se dissoudre dans leurs modèles, voilà la marque d’une diplomatie mature. Cette attitude, prudente et sélective, est souvent perçue comme lenteur. Elle est en réalité une forme supérieure de lucidité. La prudence n’est pas une hésitation : c’est une stratégie du temps long, celle qui permet d’observer avant d’agir, d’évaluer avant d’intégrer.
Mais cette diplomatie n’aurait pas de sens si elle n’était pas enracinée dans une cohérence intérieure. Hamel le rappelle subtilement : toute coopération doit être compatible avec la sensibilité nationale. L’authenticité diplomatique suppose un accord entre la voix du peuple et la voix de l’État. Autrement dit, la politique extérieure ne peut être durable que si elle exprime la conscience collective. Là réside la clé de la diplomatie authentique : elle n’est pas l’art de séduire l’extérieur, mais celui de représenter loyalement l’intérieur.
Ainsi se dessine un modèle inédit : celui d’une coopération à empreinte limitée, où l’État garde le contrôle du tempo, du champ et de la profondeur de ses engagements. C’est une diplomatie de l’équilibre et de la réversibilité — un modèle que de nombreux pays du Sud global commencent à adopter.
Conclusion :
L’article de Tewfik Hamel n’analyse pas seulement un épisode de coopération militaire : il éclaire une transformation plus profonde de la diplomatie mondiale. L’Algérie, par son art du dosage, propose une voie singulière dans un monde fracturé : rééquilibrer sans s’aligner, apprendre sans se soumettre, s’ouvrir sans se dissoudre.
Ce modèle, que l’on peut qualifier de diplomatie de l’autonomie relationnelle, annonce peut-être l’avenir de la puissance moyenne à l’ère multipolaire : un art de la prudence, de la confiance et de la compatibilité, où la souveraineté ne se mesure plus à la fermeture, mais à la capacité d’habiter la relation sans s’y perdre.
En définitive, la leçon est universelle :
La diplomatie du XXIᵉ siècle ne consiste plus à choisir un camp, mais à choisir son rythme. C’est la souveraineté des nations patientes — celles qui savent que la véritable puissance est celle qui ne s’impose pas, mais se maintient.