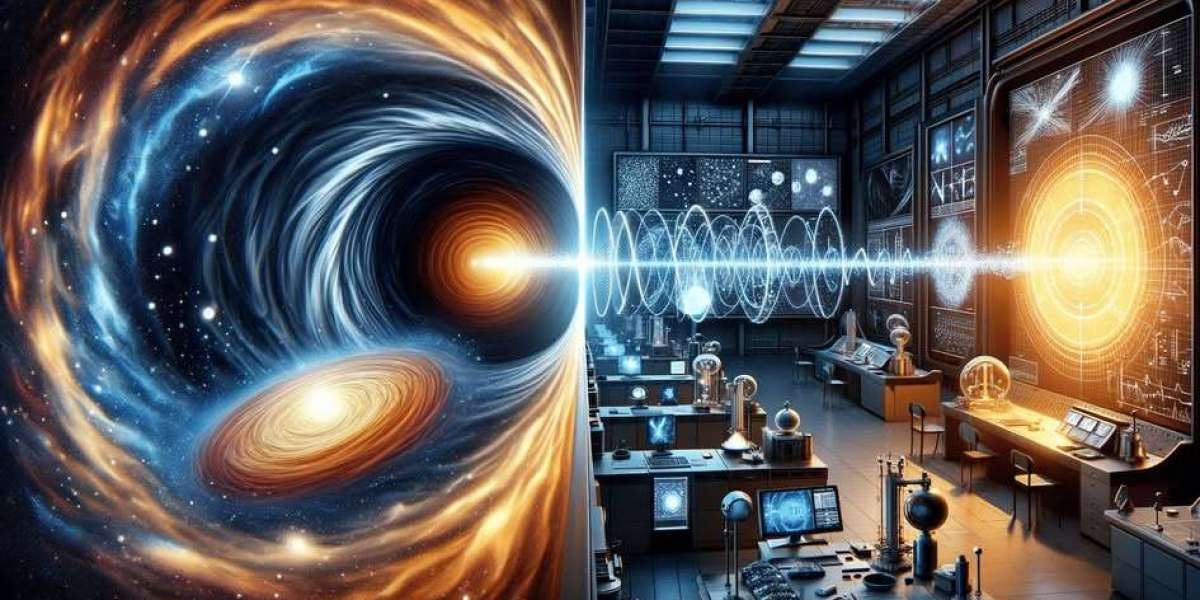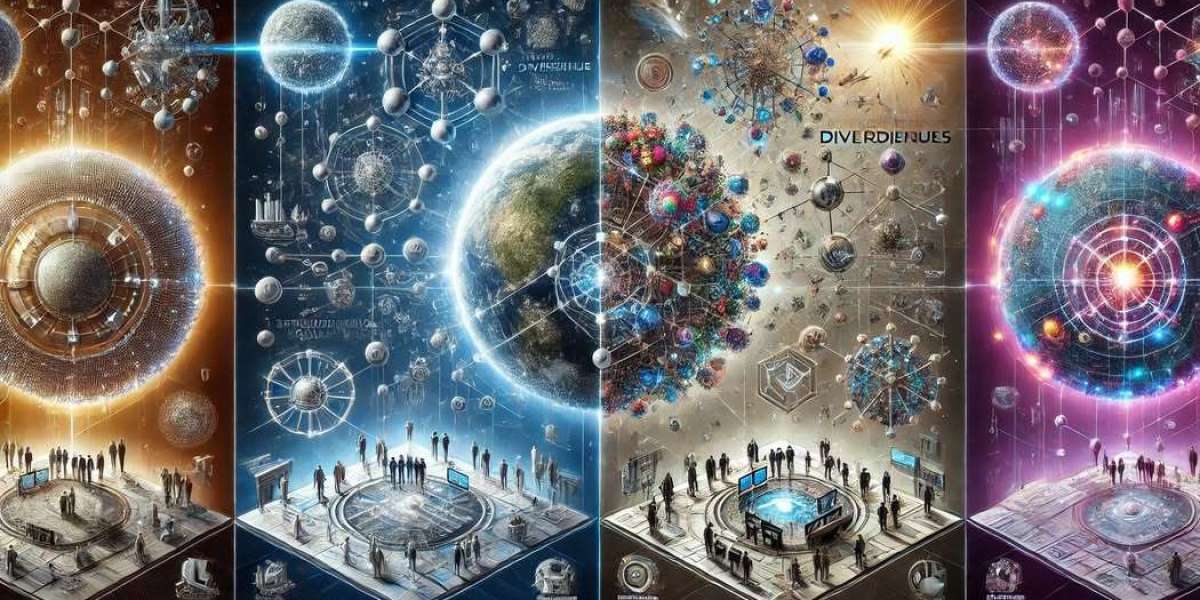Introduction :
L’histoire des sciences est marquée par une quête incessante d’unification. Les physiciens, depuis Newton jusqu’à Einstein, ont cherché à intégrer les lois qui régissent l’infiniment grand (cosmos) et celles de l’infiniment petit (particules élémentaires) en un modèle cohérent et universel. Cependant, malgré les avancées impressionnantes de la théorie des cordes, de la théorie M ou encore de la gravité quantique à boucles, l’unification demeure inachevée.
D’un autre côté, les sciences humaines et sociales font face à une crise épistémologique : souvent perçues comme moins rigoureuses que les sciences exactes, elles peinent à produire des modèles prédictifs universels en raison de la complexité et de la subjectivité de leurs objets d’étude. Pourtant, une analogie frappante apparaît entre les difficultés rencontrées par les physiciens et les défis des sciences humaines : la centralité de l’observateur et de ses représentations mentales et sociales.
C’est dans ce contexte que le champ de recherche de l’infiniment horizontal émerge, non seulement comme une extension des sciences humaines et sociales, mais comme un point de jonction entre les dynamiques de l’infiniment grand et celles de l’infiniment petit. Au cœur de cette démarche, le Natiomètre, un instrument d’observation scientifique des systèmes humains, et la Natiométrie, la discipline scientifique qui l’accompagne, ouvrent la voie à une nouvelle ère où les sciences humaines ne sont plus périphériques mais centrales dans la quête d’unification scientifique.
I. Les limites du modèle standard en physique et la quête d’unification:
Depuis le début du XXe siècle, la physique a connu deux révolutions majeures : la relativité générale d’Einstein, qui décrit les lois de l’infiniment grand, et la mécanique quantique, qui régit le comportement des particules subatomiques. Ces deux théories, bien qu’extrêmement précises et validées expérimentalement, demeurent incompatibles.
- L’infiniment grand : La relativité générale décrit un univers déterministe où l’espace-temps est une structure continue et déformable sous l’effet de la gravité.
- L’infiniment petit : La mécanique quantique repose sur des probabilités, des fonctions d’onde et une nature fondamentalement incertaine de la réalité physique.
Les tentatives d’unification, notamment la théorie des cordes ou la théorie M, proposent que les particules élémentaires ne soient pas des points, mais des cordes vibrantes existant dans des dimensions supplémentaires. Toutefois, malgré leur élégance mathématique, ces théories restent encore spéculatives et ne disposent pas de preuves expérimentales concluantes.
Au cœur de cette problématique se trouve la place centrale de l’observateur. En mécanique quantique, l’acte même d’observer modifie l’état du système observé. Cette énigme dépasse les frontières de la physique pour toucher au domaine de la perception humaine, des représentations mentales et de la subjectivité.
II. Le rôle central de l’observateur :
Un pont entre physique et sciences humaines.
L’observateur est au cœur de la mécanique quantique, où son intervention semble influencer directement le résultat de l’expérience. Cette réalité soulève une question fondamentale : Quelle est la nature de l’observateur et de ses représentations mentales et sociales ?
Les sciences humaines et sociales, qui étudient précisément ces représentations, ces croyances et ces structures mentales, apparaissent alors comme une pièce manquante dans le puzzle de l’unification des lois de la physique.
- La subjectivité scientifique : Tout acte d’observation, même scientifique, est filtré par les représentations mentales et culturelles de l’observateur.
- La construction sociale du savoir : Les paradigmes scientifiques, qu’ils soient physiques ou sociaux, sont toujours ancrés dans un contexte culturel et historique précis.
L’infiniment horizontal, en se plaçant précisément à l’intersection de ces dynamiques, offre un cadre théorique et méthodologique pour intégrer la dimension humaine et sociale dans la grande quête d’unification scientifique.
III. L’infiniment horizontal :
Une redéfinition du cadre scientifique.
L’infiniment horizontal se présente comme une extension des sciences humaines et sociales qui vise à intégrer leurs objets d’étude dans une vision systémique globale. Ce champ d’étude repose sur trois piliers fondamentaux :
- L’observation systémique des dynamiques humaines : L’infiniment horizontal permet d’observer les sociétés humaines comme des systèmes complexes et dynamiques, soumis à des interactions multiples et interdépendantes.
- La temporalité comme variable centrale : Contrairement aux sciences exactes, où le temps est souvent une dimension fixe, l’infiniment horizontal traite la temporalité humaine comme une variable dynamique et essentielle.
- La modélisation scientifique des représentations mentales et sociales : À travers des outils comme le Natiomètre, l’infiniment horizontal propose d’étudier et de quantifier les représentations humaines avec la même rigueur que les sciences exactes.
Le Natiomètre, en particulier, devient un instrument clé pour cette observation. À la manière d’un télescope pour l’infiniment grand ou d’un microscope pour l’infiniment petit, le Natiomètre permet d’explorer les dynamiques complexes des systèmes humains et nationaux.
IV. La Natiométrie :
Une science pour unifier les dynamiques humaines et naturelles.
La Natiométrie naît comme la discipline scientifique dédiée à l’étude des systèmes humains à travers l’infiniment horizontal. Elle propose une approche interdisciplinaire, combinant :
- La rigueur des mathématiques et des modèles prédictifs
- L’analyse systémique des dynamiques sociales et politiques
- L’intégration des représentations mentales et sociales dans les modèles d’observation
La Natiométrie aspire à devenir une science-pont, capable de relier les dynamiques humaines aux lois fondamentales qui structurent l’univers. Elle permet non seulement une meilleure compréhension des systèmes humains, mais offre également des outils pratiques pour éclairer les politiques publiques, la gouvernance et le développement durable.
Conclusion :
La quête d’unification des lois de la physique et les défis épistémologiques des sciences humaines et sociales trouvent un écho commun dans le champ de recherche de l’infiniment horizontal. En reconnaissant la centralité de l’observateur, de ses représentations mentales et sociales, ce champ dépasse les clivages traditionnels entre sciences exactes et humaines pour proposer un cadre novateur et systémique.
Le Natiomètre et la Natiométrie apparaissent alors comme des outils essentiels pour naviguer dans ce nouvel horizon scientifique. En intégrant l’étude des systèmes humains dans la grande quête d’unification scientifique, l’infiniment horizontal ouvre une voie prometteuse vers une compréhension globale et cohérente du monde, où l’humain et l’univers cessent d’être des réalités séparées mais deviennent deux facettes d’un même système dynamique et interconnecté.
Amirouche LAMRANI et Ania BENADJAOUD.
Chercheurs associés au GISNT.