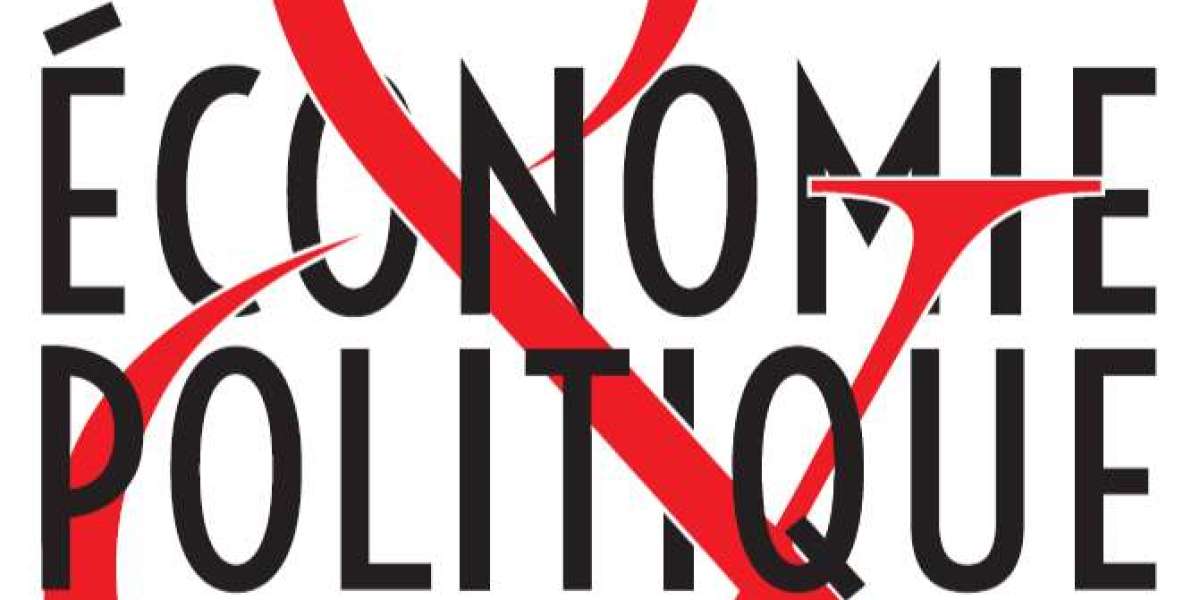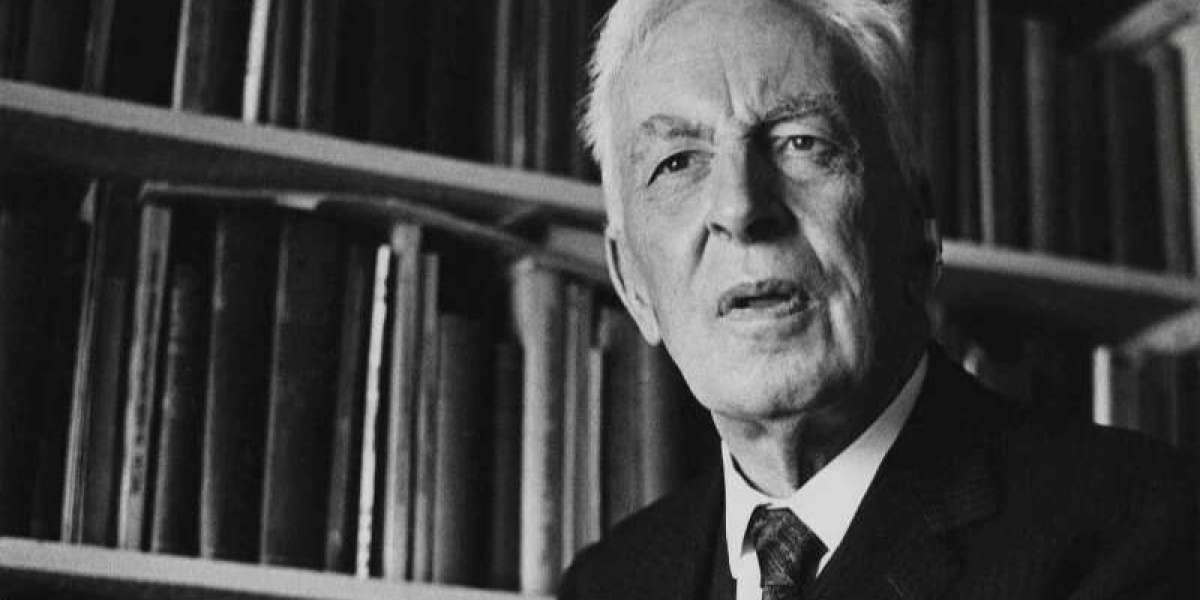I. Les fondations de l’économie politique : une science morale et politique.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’économie politique naît dans le sillage de la philosophie des Lumières. Adam Smith, Ricardo, Say, puis Marx, lient l’économie à la société et au pouvoir. Smith ne sépare jamais la « richesse des nations » de la question de la justice et de la morale ; Ricardo s’interroge sur la distribution entre classes ; Marx dévoile les rapports d’exploitation au cœur du capitalisme. À ce stade, l’économie politique est une science du vivre-ensemble, attentive au rôle des institutions, des conflits sociaux et des choix collectifs.II. Le moment de la coupure : de l’économie politique à la science économique.
À la fin du XIXe siècle, les marginalistes (Walras, Jevons, Menger) proposent une rupture radicale : l’économie ne doit plus être une réflexion historique et politique, mais une science exacte fondée sur des équations. Les acteurs économiques sont réduits à des individus rationnels, calculateurs, abstraits. La société disparaît, le politique s’efface. Au XXe siècle, cette orientation s’impose. L’économie devient ingénierie de marché, mathématisation, modélisation. La discipline perd son souffle critique. Le fil est rompu.III. Les courants de résistance : maintenir le souffle de l’économie politique.
Pourtant, l’économie politique n’a jamais totalement disparu. Plusieurs courants ont tenté de la réactiver :- Les institutionnalistes (Veblen, Commons, North) : l’économie est ancrée dans des règles, des normes, des structures sociales.
- Les conventionnalistes (Orléan, Favereau, Thévenot) : les marchés ne reposent pas sur des lois naturelles, mais sur des conventions partagées.
- Les régulationnistes (Aglietta, Boyer) : les crises et cycles économiques proviennent de compromis sociaux et institutionnels.
- Les économistes écologiques (Georgescu-Roegen, Daly) : toute économie est inséparable des limites de la biosphère.
- Les approches féministes et postcoloniales : elles rappellent que le travail invisible, les rapports de genre et l’extraction coloniale sont constitutifs de la richesse.
IV. Pourquoi ce silence ? Les raisons politiques de l’effacement.
La marginalisation de l’économie politique n’est pas seulement scientifique, elle est politique.- Après la Seconde Guerre mondiale, sous influence américaine, la science économique s’uniformise autour d’un paradigme néoclassique-keynésien.
- La guerre froide rend suspecte toute pensée trop critique, assimilée au marxisme.
- Les années 1980, avec l’essor néolibéral, parachèvent la coupure : l’économie devient un instrument de gestion au service des marchés financiers. Ainsi, le silence de l’économie politique fut voulu : il fallait neutraliser une discipline capable de dévoiler les rapports de domination.
V. La Natiométrie comme réactivation : renouer le fil.
La Natiométrie se présente aujourd’hui comme une voie pour réhabiliter l’économie politique. En proposant une science du phénomène nation comme méta-système, elle offre :- Une méthode pour relier économie, politique, culture et histoire dans une lecture intégrée.
- Un instrument, le Natiomètre, capable de mesurer et d’analyser les dynamiques des nations au-delà des seuls indicateurs économiques.
- Une grille qui articule les forces invisibles (psychiques, symboliques, civilisationnelles) et les forces visibles (matérielles, institutionnelles).
Conclusion :
L’économie politique a été mise en silence parce qu’elle osait interroger les fondements mêmes du pouvoir économique et social. Mais ce silence n’a jamais été total : des voix dissidentes ont maintenu son souffle. Aujourd’hui, la Natiométrie offre l’opportunité de renouer ce fil, en intégrant les apports de ces courants hétérodoxes et en les élevant dans une perspective plus vaste, qui articule science, technologie et civilisation. En ce sens, la Natiométrie n’est pas seulement un prolongement de l’économie politique : elle en est une refondation, à la hauteur des défis du XXIe siècle.