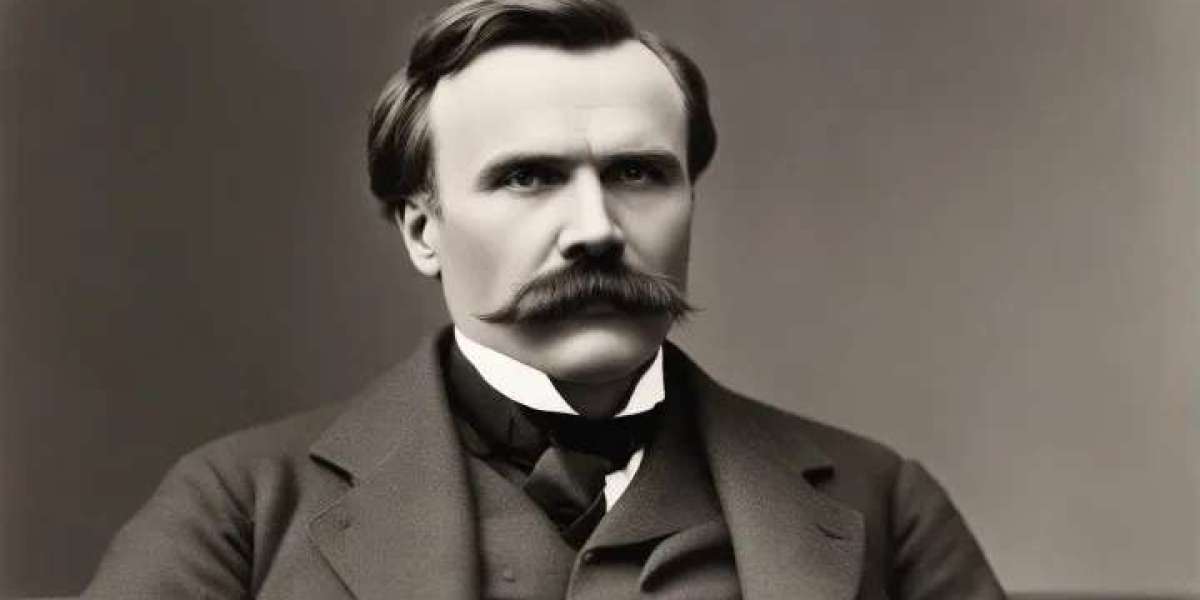Introduction :
Un fil rompu, un fil à renouer.
L’économie politique naquit comme une quête d’intelligibilité du monde humain, une science de la richesse et de la justice, des échanges et des sociétés. Mais ce souffle originel fut interrompu : la mathématisation néoclassique et la technicisation néolibérale ont réduit l’économie à une ingénierie abstraite, détachée de ses racines politiques et morales. Pourtant, à travers les siècles, des voix dissidentes ont résisté, cherchant à maintenir vivant le lien entre économie et société. Ces voix, dispersées, forment un chœur que la Natiométrie peut aujourd’hui réunir. Car la Natiomètrie, en s’érigeant en science des nations, ne nie aucun de ces héritages : il les rassemble dans une matrice plus vaste, à la mesure des défis civilisationnels.
I. Les classiques et les critiques : la matrice originelle.
À l’aube de la modernité, Adam Smith liait la richesse des nations à la morale des peuples. Ricardo explorait la répartition entre classes, tandis que Marx révélait les contradictions internes du capitalisme. Ici, l’économie politique était une science du destin collectif : elle scrutait les forces qui structurent la société et osait interroger la justice. La Natiométrie reprend ce souffle inaugural : comme Smith ou Marx, elle ne sépare pas l’économie du politique, mais les embrasse dans une vision systémique. Elle réinscrit la dynamique économique dans une histoire longue des nations, mesurable sur le cadran natiométrique.
II. Les institutionnalistes et les conventionnalistes : les règles invisibles du jeu.
Quand la science économique dominante réduisait les individus à des calculatrices rationnelles, Veblen, Commons et North rappelaient que l’économie est d’abord une institution sociale, faite de règles, de normes et d’habitudes. Plus tard, Orléan, Favereau et Thévenot montrèrent que la valeur et la confiance ne naissent pas de lois naturelles mais de conventions partagées. La Natiométrie recueille cet héritage : elle conçoit les nations comme des systèmes conventionnels, où l’économie n’est qu’un tissu de règles symboliques et juridiques. Le Natiomètre peut ainsi mesurer non seulement la richesse matérielle, mais aussi la densité normative et symbolique qui soutient les nations.
III. Les régulationnistes : les cycles de l’histoire.
Aglietta et Boyer démontrèrent que les crises ne sont pas des accidents, mais les fruits de compromis sociaux et de régimes d’accumulation. Leur pensée inscrivit l’économie dans des cycles longs, faits de stabilités provisoires et de ruptures. Le Natiomètre prolonge cette intuition : il traduit ces régimes en dynamiques mesurables sur son cadran de 128 ans. La Natiométrie devient ainsi une science des rythmes civilisationnels, capable de relier le battement des cycles économiques à l’évolution des nations.
IV. Les voix écartées : écologie, féminisme, décolonialité
À la marge du champ dominant, d’autres voix portèrent des critiques fondamentales.
-
Georgescu-Roegen et Daly rappelèrent que toute économie est arrimée aux lois de la biosphère.
-
Folbre et Federici révélèrent l’immense masse de travail invisible qui soutient la vie sociale.
-
Samir Amin et Walter Rodney dévoilèrent les rapports de dépendance et d’extraction qui structurent l’économie mondiale. Ces approches furent marginalisées, car elles dérangeaient l’ordre établi. Mais la Natiométrie leur redonne place : elle inscrit la nation dans son écologie, dans son tissu social invisible, et dans son rapport asymétrique au monde.
V. La Natiométrie comme synthèse et dépassement :
La force de la Natiométrie est d’offrir un cadre où ces héritages épars ne s’opposent plus, mais se complètent.
-
Des classiques, elle retient la vision morale et collective.
-
Des institutionnalistes et conventionnalistes, elle intègre la centralité des règles et conventions.
-
Des régulationnistes, elle hérite des cycles historiques.
-
Des voix écologiques, féministes et décoloniales, elle recueille l’exigence de justice, de durabilité et de reconnaissance.
Dans le Natiomètre, tous ces apports se recomposent en un étalon civilisationnel, qui mesure non seulement la richesse, mais la vitalité, la stabilité et la justice des nations.
Conclusion :
De la dispersion à la matrice.
Ce que la science économique dominante a voulu taire, la Natiométrie le fait résonner à nouveau. Elle n’invente pas ex nihilo : elle tisse ensemble les fils rompus, les voix marginalisées, les héritages étouffés. Mais elle ne se contente pas de restaurer l’économie politique : elle la transfigure en une science de l’Anthropos collectif, de l’évolution des nations et des civilisations. Ainsi, ce qui fut réduit au silence devient, par la Natiométrie, une matrice nouvelle pour l’histoire : une science non pas au service de la domination, mais au service de l’émancipation des sociétés humaines.